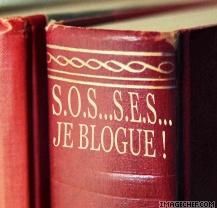Ce thème, grand classique de la sociologie est revenu sur le devant de l'actualité médiatique ces dernières semaines.
 La preuve ? Le Nouvel Observateur de cette semaine au titre évocateur ne manque pas l'occasion de soulever le problème de ce "fameux ascenseur social".
La preuve ? Le Nouvel Observateur de cette semaine au titre évocateur ne manque pas l'occasion de soulever le problème de ce "fameux ascenseur social". Les articles (dont quelques uns sont signés de Florence Aubenas) révèlent un traitement "journalistique" du problème: beaucoup de symboles et de témoignages qui sont certes très intéressants, mais qui, personnellement, me laissent "un peu sur ma faim" (je sais, vous me direz, déformation professionnelle).
Que peuvent nous apporter les sciences sociales au sujet de cette idée répandue dans toute l'opinion: "l'ascenseur social est en panne" ?
Il convient de s'appuyer sur les recherches actuelles. Je voudrais alors saisir la parution d'un livre d'un sociologue (Louis Chauvel) dont les analyses feront l'objet de ce premier article. Ensuite, un autre article apportera d'autres éléments de réponse qui serviront de contrepoint à cet article.
 Qui est Louis Chauvel ? Voici son site personnel ici
Qui est Louis Chauvel ? Voici son site personnel iciJe vous conseille d'écouter les fichiers audio sur Europe 1 et france inter.
Un extrait d'une interview de Louis Chauvel au journal gratuit 20 minutes du 23/10/06 (source complète ici)
Les jeunes qui ont défilé contre le CPE ont pris conscience qu'avec un niveau d'études souvent supérieur à celui de leurs parents, leurs débuts dans la vie active sont bien plus compliqués. Un bon indicateur est aussi la relation que l'on a à la voiture. Des études montrent que dans les années 70, la vieille 2CV convenait plutôt à des personnes âgées. Les jeunes se portaient plutôt vers les voitures neuves. Aujourd'hui, au contraire, ils veulent reprendre le véhicule de leurs parents.
 Depuis quand observe-t-on cette crise ?
Depuis quand observe-t-on cette crise ? Difficile de donner un point de départ précis. Il vaut mieux réfléchir en terme générationnel. Tous ceux qui sont entrés sur le marché du travail après le début des années 70 ont assisté à la fin de « trente glorieuses ». Pendant les années 80, on a vu arriver la nouvelle pauvreté, avec le RMI et le chômage de masse. Plus récemment, l'événement marquant est l'éclatement de la bulle Internet.
Les jeunes ne peuvent-ils pas compter sur l'aide de leur famille ?
A moyen terme, la solidarité familiale permet d'amortir les difficultés matérielles. Mais elle conduit aussi les jeunes à accepter des salaires trop bas. En miroir, l'importance que prend la famille marque aussi un affaiblissement de la méritocratie traditionnelle. Dans certaines professions, à compétence égale, le piston est devenu déterminant.
Peut-on relier cette analyse aux émeutes qui ont touché les banlieues en 2005 ?
Le désarroi des classes moyennes resurgit forcément sur les classes populaires. Si les temps sont incertains au niveau intermédiaire, une ascension sociale semble devenir totalement improbable.
Les nouvelles générations devant la panne prolongée de l'ascenseur social
Le premier élément concerne la dynamique de la structure sociale, qui peut être
Inégalités de niveau de vie de différentes classes d'âges (1979-1999) (rapport interdécile)
| | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |
| 1979 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 5.1 |
| 1999 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 4.1 |
Clé de lecture : en 1999, le revenu des 10 % les plus riches parmi les 25-29 ans était 3.1 fois plus élevé que le revenu des 10 % les plus pauvres parmi les 25-29 ans.
Le deuxième ensemble de phénomènes relève des chances de mobilité sociale
intergénérationnelle et des phénomènes de déclassements sociaux, soit par rapport à ses propres parents, soit par rapport au niveau de diplôme atteint . On constate en effet un important revirement des chances d'ascension sociale : les parents de la génération née en 1945, parce qu?ils sont nés en moyenne autour de 1910-1915, ont connu en moyenne un sort difficile.
Un quart d'orphelins précoces, un quart d'enfants d'invalides, une jeunesse dans la crise de l'entre-deux guerres, puis la seconde guerre mondiale. La reprise des Trente glorieuses (1945-1975) les attend, mais ils ont déjà 36 ans lorsque le système de retraite est créé, exigeant d'eux 35 années de cotisations pour une retraite pleine, un contrat pour eux inaccessible : pour la majorité, ce fut une vieillesse misérable dans une société de jeunes riches.
Pour la génération née vers 1945, les premiers nés du baby boom, l'ascenseur social a bien fonctionné par rapport à leurs parents. Pour leurs propres enfants, nés vers 1975, ces conditions d'ascension sociale sont souvent compromises, ces jeunes d'aujourd'hui étant les enfants non plus d'une génération sacrifiée mais d'une génération dorée.

C'est ainsi que lorsque l'on compare sur près de vingt ans les chances d'ascension sociale et les risques de déclassements sociaux par rapport au père, la classe d'âge 50-54 ans a connu une forte hausse des chances d'ascension, alors que les 30-34 ans ont vu ces chances fléchir. Pour ce qui est des risques de mobilité descendante, les 50-54 ans n'ont pas vu d'accroissement de ce risque, contrairement aux 30-34 ans, qui maintenant font face à presque autant de risques de déclin que d'ascension sur la pyramide sociale.

La question de la valorisation des titres scolaires pose des difficultés plus radicales encore. La seconde explosion scolaire de la fin des années quatre-vingt qui a porté entre 1988 et 1994 de 30 % à 62 % une classe d'âge au baccalauréat, et de 10 à plus de 20 % les titulaires d'une licence, complète largement ce processus où, par surabondance de diplômés par rapport aux positions sociales disponibles, une partie importante des jeunes diplômés ne peuvent plus envisager les mêmes carrières que celles de leurs aînés.
source: Les nouvelles générations devant la panne prolongée de l'ascenseur social, Louis Chauvel OFCE, Janvier 2006